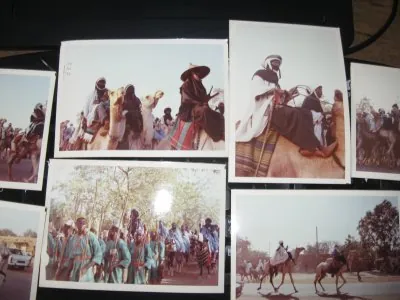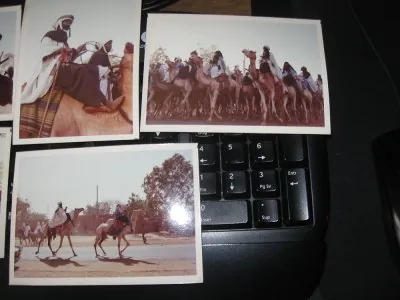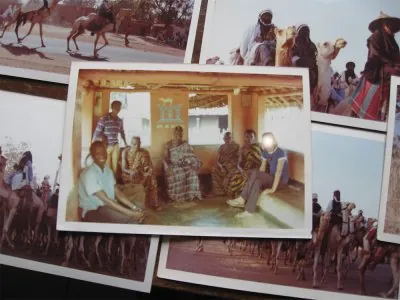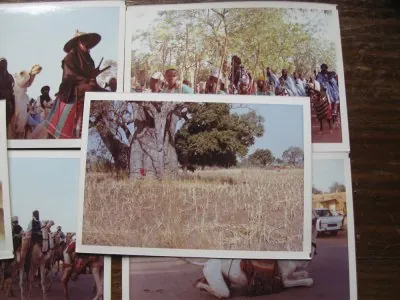Pour changer un peu du McDo lorsque vous allez en vacances au Maroc....  Certaines plantes du désert sont comestibles.
Certaines plantes du désert sont comestibles.
Lorsque l’on pense au désert, on imagine une étendue aride de sable et de cailloux où toute forme de vie, végétale ou animale, paraît impossible. Manque d’eau, excès de chaleur et d’écarts de températures entre le jour et la nuit, luminosité intense, irrégularité des pluies, vents asséchants… tous ces facteurs semblent incompatibles avec le règne végétal. Le voyageur de passage remarquera tout au plus quelques touffes sèches qui surgissent des dunes de sable, quelques arbres isolés appréciés surtout pour l’ombre qu’ils procurent. Il s’étonnera de voir des traces non identifiées sur le sable au petit matin, témoignant d’une vie nocturne intense. Mais lorsque l’on se donne la peine de séjourner quelques temps dans ce lieu infini, l’on découvre une diversité insoupçonnée d’espèces et l’on s’étonne de voir leur capacité d’adaptation à un lieu, à priori, si hostile.
Le massif dunaire de Chegaga est, avec l’erg Chebbi (Merzouga), la plus grande étendue désertique du Maroc. Difficile d’accès, on y arrive par la piste depuis Mhamid à l’est ou depuis Foum Zguid et le lac Iriki à l’ouest.
Le début du printemps est la période idéale pour découvrir la nature sauvage du désert, dans les zones arborées et aux abords des points d’eau. Là se concentrent de nombreuses espèces européennes d’oiseaux en transit lors de leur migration vers le Nord où ils retrouvent leurs quartiers d’été (guêpiers, hirondelles et martinets, cigognes, traquets, pouillots, fauvettes…), ou des espèces nidificatrices nord-africaines (ganga, sirli, Traquets à tête grise, à tête blanche, du désert, oreillard…, Moineau blanc, Fauvette de l’Atlas, ammomanes, Roselin githagine, Corbeau brun…).
Quant aux espèces botaniques, il en ressort quelques-unes qui s’observent et s’identifient aisément. La grande étendue dépressionnaire qui s’étend entre les dunes de Chegaga et le Jbel Bani se recouvrent d’une prairie de roquettes qui fait le bonheur des bergers et de leurs troupeaux.


Les feuilles peuvent être consommées cuites ajoutées à des bouillies ou à des sauces. On lui attribue le nom de « chou du désert ».


Cette plante toxique contient des alcaloïdes très actifs provoquant hallucinations et vertiges susceptibles d’entrainer la mort chez l’homme. Les ruminants semblent épargnés car il leur arrive d’en brouter des touffes sans conséquences. En revanche, si l’on consomme un animal qui a mangé la veille cette plante (sauterelle, tripes d’une gazelle…), les effets seront fatals.


Lorsque l’on pense au désert, on imagine une étendue aride de sable et de cailloux où toute forme de vie, végétale ou animale, paraît impossible. Manque d’eau, excès de chaleur et d’écarts de températures entre le jour et la nuit, luminosité intense, irrégularité des pluies, vents asséchants… tous ces facteurs semblent incompatibles avec le règne végétal. Le voyageur de passage remarquera tout au plus quelques touffes sèches qui surgissent des dunes de sable, quelques arbres isolés appréciés surtout pour l’ombre qu’ils procurent. Il s’étonnera de voir des traces non identifiées sur le sable au petit matin, témoignant d’une vie nocturne intense. Mais lorsque l’on se donne la peine de séjourner quelques temps dans ce lieu infini, l’on découvre une diversité insoupçonnée d’espèces et l’on s’étonne de voir leur capacité d’adaptation à un lieu, à priori, si hostile.
Le massif dunaire de Chegaga est, avec l’erg Chebbi (Merzouga), la plus grande étendue désertique du Maroc. Difficile d’accès, on y arrive par la piste depuis Mhamid à l’est ou depuis Foum Zguid et le lac Iriki à l’ouest.
Le début du printemps est la période idéale pour découvrir la nature sauvage du désert, dans les zones arborées et aux abords des points d’eau. Là se concentrent de nombreuses espèces européennes d’oiseaux en transit lors de leur migration vers le Nord où ils retrouvent leurs quartiers d’été (guêpiers, hirondelles et martinets, cigognes, traquets, pouillots, fauvettes…), ou des espèces nidificatrices nord-africaines (ganga, sirli, Traquets à tête grise, à tête blanche, du désert, oreillard…, Moineau blanc, Fauvette de l’Atlas, ammomanes, Roselin githagine, Corbeau brun…).
Quant aux espèces botaniques, il en ressort quelques-unes qui s’observent et s’identifient aisément. La grande étendue dépressionnaire qui s’étend entre les dunes de Chegaga et le Jbel Bani se recouvrent d’une prairie de roquettes qui fait le bonheur des bergers et de leurs troupeaux.
. Eruca sativa (Roquette sauvage) – BRASSICACEAE
La Roquette sauvage (Eruca sativa) se caractérise par ses touffes denses de feuilles très découpées, ses fleurs jaunâtres à 4 pétales, son odeur et sa saveur plus fortes que celles de la roquette cultivée, immédiatement reconnaissables par tous ceux qui l’ont dégustée en salade cuite à la mode berbère. Jeune, cette plante est un fourrage de choix pour les troupeaux. Puis lorsqu’elle grandit, elle devient trop amère et les bêtes s’en éloignent. Elle est alors cueillie massivement par les villageois qui la mettent à sécher ; la dessication lui fait perdre le goût amer et elle est stockée comme foin pour l’été.

2. Schouwia thebaïca (Chou du désert) – BRASSICACEAE (consommable)
Cette grande plante herbacée annuelle dispose de larges feuilles charnues, vert bleuté et plus ou moins en forme de cœur. Les fleurs en grappes à l’extrémité des tiges ont quatre pétales violet mauve. Les fruits aplatis (silicules) sont bordés par une aile. Cette plante pousse rapidement après la pluie, en terrain sablonneux, et fait ressembler le désert à une prairie. C’est une excellent pâturage pour les chameaux et pour les chèvres et sa présence détermine le déplacement des troupeaux.Les feuilles peuvent être consommées cuites ajoutées à des bouillies ou à des sauces. On lui attribue le nom de « chou du désert ».


3. Hyoscyamus muticus (Jusquiame falzelez) – SOLANACEAE
Présente dans tout le Sahara, la Jusquiame falezlez (Hyoscyamus muticus) forme de véritables colonies sur les sols argileux et argilo-sableux. La plante repousse rapidement après chaque pluie, mais la souche plus ou moins ligneuse résiste très bien à la sécheresse. Elle apparaît en touffes imposantes de 40 à 60 cm et se reconnaît à ses fleurs en cymes à grand calice veiné, composée de 5 pétales soudés en forme d’entonnoir sur les 3/4 de leur longueur puis évasés vers l’extérieur, 3 pétales noirs en haut, 2 pétales mauves rayés de blanc en bas. Les feuilles sont charnues, un peu visqueuses et recouvertes d’une fine pilosité. Forme et dimension varie selon leur position sur la tige.Cette plante toxique contient des alcaloïdes très actifs provoquant hallucinations et vertiges susceptibles d’entrainer la mort chez l’homme. Les ruminants semblent épargnés car il leur arrive d’en brouter des touffes sans conséquences. En revanche, si l’on consomme un animal qui a mangé la veille cette plante (sauterelle, tripes d’une gazelle…), les effets seront fatals.