didadoune
VIB
C’est une discussion banale, plaisante, entre amis. Et soudain, la question tombe comme un couperet : « tu l’as lu, ce livre ? »
Doit-on nécessairement avoir lu un livre pour pouvoir en parler ? Le monde se divise-t-il en deux catégories : ceux qui ont lu et ceux qui n’ont pas lu ? La non-lecture est peut-être affaire plus complexe.
Pierre Bayard nous invite à y réfléchir dans son ouvrage Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? paru en 2007 aux Éditions de Minuit. Suivons son raisonnement pour éviter les mauvaises chutes lors de nos prochaines discussions.
Au-delà de l’opposition lecture versus non-lecture
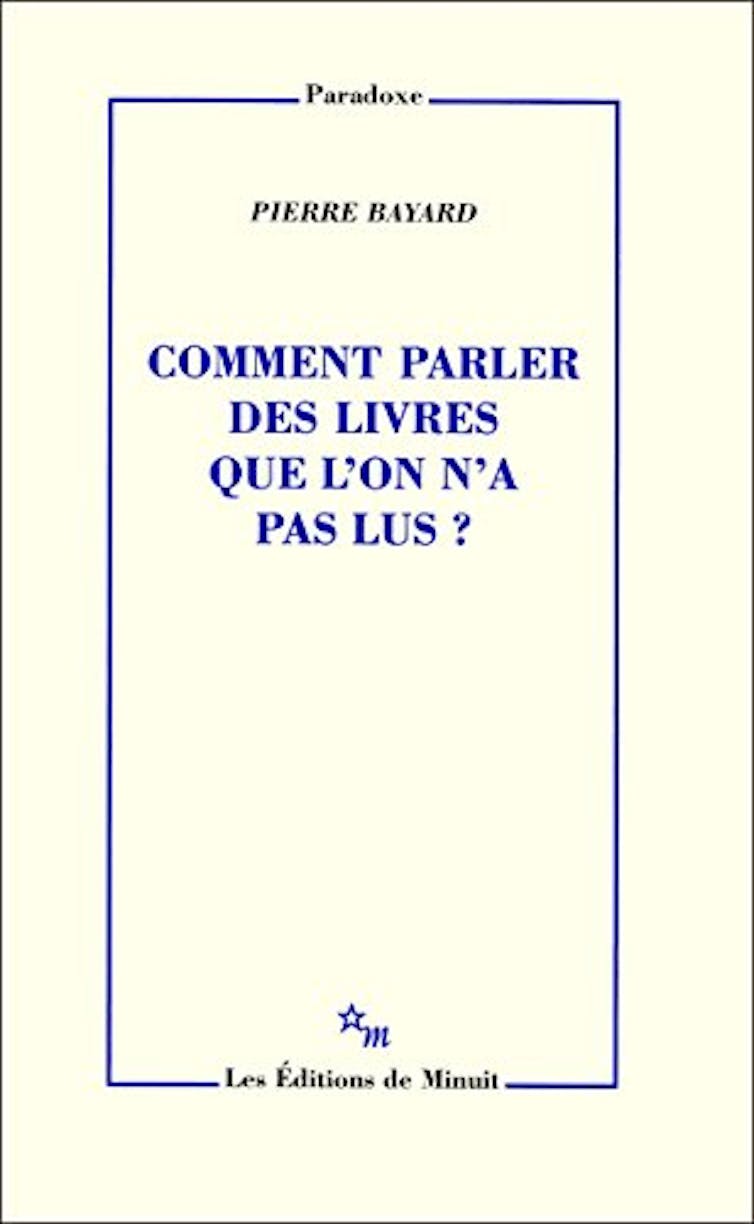
Le livre de Pierre Bayard, sorti en 2007.
Commençons par un changement de paradigme : lire ou ne pas lire n’est pas la bonne question. Pierre Bayard nous propose d’envisager quatre types de non-lecture de livres : le livre parcouru, le livre oublié, le livre dont on a entendu parler et le livre inconnu.
Car lire un livre consiste parfois à le parcourir. Un morceau par ci, un autre par là. Un paragraphe sauté. Quelques lignes aperçues. Des moments d’absence mais des pages qui se tournent. On avance sans avoir tout lu, sans avoir compris chaque mot, identifié chaque virgule, saisi chaque silence. Qu’il s’agisse d’un parcours linéaire (où l’on saute des lignes et paragraphes) ou morcelé (où l’on vient picorer ça et là de quoi assouvir notre curiosité), ce premier type de non-lecture permet de « maintenir une distance raisonnable avec le livre […] pour ne pas se perdre dans les détails ».
De ces livres parcourus, on ne retient pas tout. Que de livres parcourus ont été oubliés ! Et que de passages, de chapitres dont nous n’avons pas retenu le moindre mot au moment d’en parler ! L’oubli n’est pas seulement un défaut de mémoire, c’est aussi une qualité essentielle pour penser. Comme l’écrivait Jorge Luis Borges dans son récit sur l’hypermnésique Irénée Funes : « Penser c’est oublier des différences, c’est généraliser, abstraire. »
Une troisième catégorie de « non-lecture » correspond aux « livres entendus ». Discussions entre amis, émissions télévisées, bancs de l’école ou de l’Université… Les occasions où l’on entend parler de livres sont nombreuses. Tous ces discours que les autres portent sur des écrits que nous n’avons jamais lus participent à étendre notre connaissance ; il convient donc de ne point les négliger.
Ce type de non-lecture est essentiel à double titre. D’une part, il rappelle le rôle essentiel des discours sur les livres, donc la part de l’Autre dans la construction de nos connaissances. D’autre part, il constitue un carrefour où transitent la lecture comme la non-lecture. En effet, même d’un livre lu, on entend parler ; et cela peut participer à une relecture intérieure.
Enfin, bien que ces trois types de non-lecture participent à la complexification du rapport à la lecture, il convient de ne pas exclure la possibilité de ne pas avoir lu du tout un livre. Ni parcouru, ni oublié, parfois pas entendu parler : le livre « inconnu » ne nous condamne pourtant pas au silence. On pourrait en dire bien des choses en somme ! À condition d’accepter que, comme l’humain, le livre passe le livre…
Doit-on nécessairement avoir lu un livre pour pouvoir en parler ? Le monde se divise-t-il en deux catégories : ceux qui ont lu et ceux qui n’ont pas lu ? La non-lecture est peut-être affaire plus complexe.
Pierre Bayard nous invite à y réfléchir dans son ouvrage Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? paru en 2007 aux Éditions de Minuit. Suivons son raisonnement pour éviter les mauvaises chutes lors de nos prochaines discussions.
Au-delà de l’opposition lecture versus non-lecture
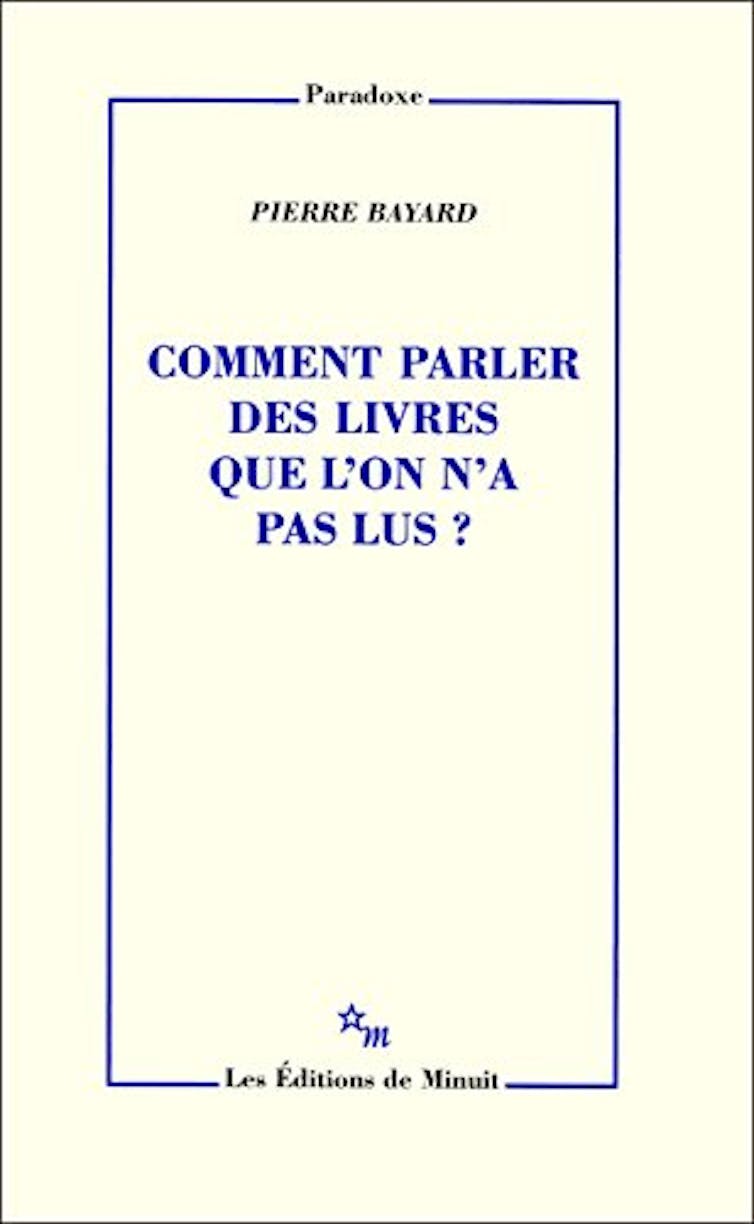
Le livre de Pierre Bayard, sorti en 2007.
Commençons par un changement de paradigme : lire ou ne pas lire n’est pas la bonne question. Pierre Bayard nous propose d’envisager quatre types de non-lecture de livres : le livre parcouru, le livre oublié, le livre dont on a entendu parler et le livre inconnu.
Car lire un livre consiste parfois à le parcourir. Un morceau par ci, un autre par là. Un paragraphe sauté. Quelques lignes aperçues. Des moments d’absence mais des pages qui se tournent. On avance sans avoir tout lu, sans avoir compris chaque mot, identifié chaque virgule, saisi chaque silence. Qu’il s’agisse d’un parcours linéaire (où l’on saute des lignes et paragraphes) ou morcelé (où l’on vient picorer ça et là de quoi assouvir notre curiosité), ce premier type de non-lecture permet de « maintenir une distance raisonnable avec le livre […] pour ne pas se perdre dans les détails ».
De ces livres parcourus, on ne retient pas tout. Que de livres parcourus ont été oubliés ! Et que de passages, de chapitres dont nous n’avons pas retenu le moindre mot au moment d’en parler ! L’oubli n’est pas seulement un défaut de mémoire, c’est aussi une qualité essentielle pour penser. Comme l’écrivait Jorge Luis Borges dans son récit sur l’hypermnésique Irénée Funes : « Penser c’est oublier des différences, c’est généraliser, abstraire. »
Une troisième catégorie de « non-lecture » correspond aux « livres entendus ». Discussions entre amis, émissions télévisées, bancs de l’école ou de l’Université… Les occasions où l’on entend parler de livres sont nombreuses. Tous ces discours que les autres portent sur des écrits que nous n’avons jamais lus participent à étendre notre connaissance ; il convient donc de ne point les négliger.
Ce type de non-lecture est essentiel à double titre. D’une part, il rappelle le rôle essentiel des discours sur les livres, donc la part de l’Autre dans la construction de nos connaissances. D’autre part, il constitue un carrefour où transitent la lecture comme la non-lecture. En effet, même d’un livre lu, on entend parler ; et cela peut participer à une relecture intérieure.
Enfin, bien que ces trois types de non-lecture participent à la complexification du rapport à la lecture, il convient de ne pas exclure la possibilité de ne pas avoir lu du tout un livre. Ni parcouru, ni oublié, parfois pas entendu parler : le livre « inconnu » ne nous condamne pourtant pas au silence. On pourrait en dire bien des choses en somme ! À condition d’accepter que, comme l’humain, le livre passe le livre…


