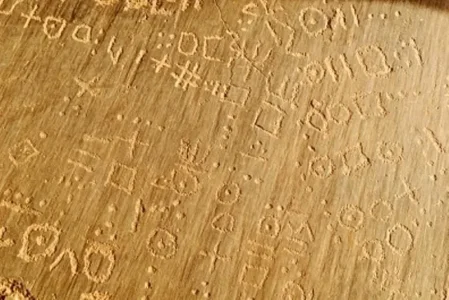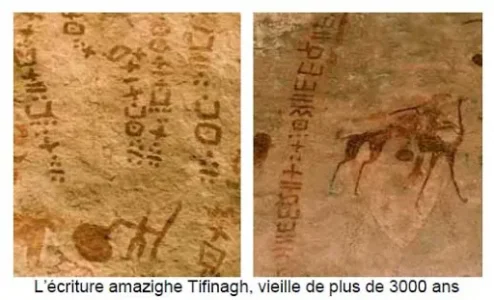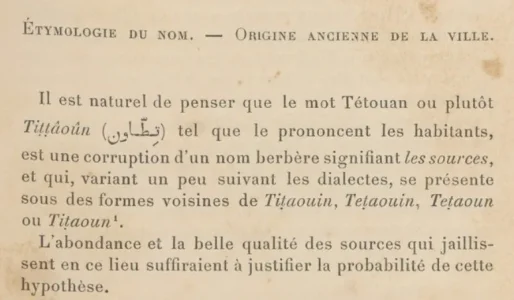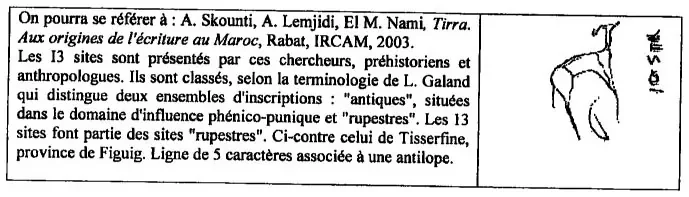Salut à tous et à toutes,
j'espère que vous allez tous bien,
Alors notre sujet est autour des noms d'origine des villes marocaines, y'en certainement beaucoup qui ne le savent pas, mais beaucoup de noms des villes ont été traduit littéralement en arabe, ou falsifié (genre juste pour changer le noms d'origine mais sans chercher un sens au noms donné après.. Nom truqué). Mais heureusement comme l'état ne peut pas changer toutes la toponymie du Maroc, il a laissé beaucoup de ville et région.
Ci dessus des noms rester intact comme:
Tiznit, Tafraout, Agadir, Aït melloul, Tikiwin, tindouf, lgouira....
Aussi:
Ifran, ifni,...
Connaissez vous quelques chose sur ce sujet ?
De quelle langue viennent les noms des lieux au Maroc ?
Pourquoi certains sont truqué linguistiquement ?
Pourquoi l'état n'a pas réussit la transformation de la totalité des noms et pourquoi il a besoin de faire ceci?
Un petit aperçu sur la toponymie et sa relation avec l'identité marocaine ?
Puis s'il y'a des arabes au Maroc pourquoi la toponymie arabe n'existe pas au Maroc et s'il y'a d'autres peuple aussi divers sur cette terre, pourquoi il n y'a pas de trace de leur langue sur la toponymie ?
Merci bien.
j'espère que vous allez tous bien,
Alors notre sujet est autour des noms d'origine des villes marocaines, y'en certainement beaucoup qui ne le savent pas, mais beaucoup de noms des villes ont été traduit littéralement en arabe, ou falsifié (genre juste pour changer le noms d'origine mais sans chercher un sens au noms donné après.. Nom truqué). Mais heureusement comme l'état ne peut pas changer toutes la toponymie du Maroc, il a laissé beaucoup de ville et région.
Ci dessus des noms rester intact comme:
Tiznit, Tafraout, Agadir, Aït melloul, Tikiwin, tindouf, lgouira....
Aussi:
Ifran, ifni,...
Connaissez vous quelques chose sur ce sujet ?
De quelle langue viennent les noms des lieux au Maroc ?
Pourquoi certains sont truqué linguistiquement ?
Pourquoi l'état n'a pas réussit la transformation de la totalité des noms et pourquoi il a besoin de faire ceci?
Un petit aperçu sur la toponymie et sa relation avec l'identité marocaine ?
Puis s'il y'a des arabes au Maroc pourquoi la toponymie arabe n'existe pas au Maroc et s'il y'a d'autres peuple aussi divers sur cette terre, pourquoi il n y'a pas de trace de leur langue sur la toponymie ?
Merci bien.