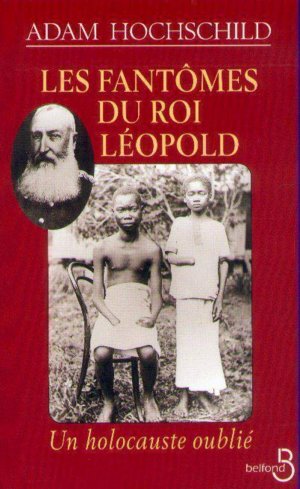Arnaud Orain relit l’histoire du capitalisme sous l’angle de l’accaparement des ressources, en analysant ses logiques d’appropriation, de domination et de contournement du marché.
Karl Polanyi situe l’apogée du capitalisme entre 1830 et 1930, période durant laquelle le système de marché autorégulé s’impose, entraînant la marchandisation de la terre, du travail et de la monnaie. Après la Seconde Guerre mondiale, nos sociétés connaîtront une démarchandisation partielle du travail et de la monnaie. Toutefois, la révolution néolibérale des années 1980 est perçue par de nombreux critiques comme une nouvelle poussée de ce système. Depuis 2010, ce dernier doit faire face à une série de crises de plus en plus graves.
L’économiste et historien Arnaud Orain propose une périodisation différente dans son ouvrage Le Monde confisqué. Il y retrace l’histoire d’un capitalisme qu’il décrit comme « capitalisme de la finitude » — qu’on pourrait aussi qualifier de « capitalisme d’accaparement » — s’étendant du XVIe siècle à nos jours, dont il affirme qu’il réapparaît périodiquement en dehors des périodes durant lesquelles le capitalisme libéral réussit à s’imposer.
La résurgence périodique d’une volonté d’accaparement des ressources à l’international
Son analyse se concentre principalement sur les échanges internationaux – davantage de biens que de services – laissant ainsi de côté d’autres dimensions généralement considérées dans l’analyse du capitalisme et de son émergence. Selon Orain, les périodes où le capitalisme libéral et le libre-échange dominent se limitent à deux séquences : de 1815 à 1880 (avec un pic entre 1850 et 1870) et de 1945 à 2010 (jusqu’en 1980, sous une forme tempérée par l’intervention publique). À l’inverse, il identifie trois périodes clés durant lesquelles prédomine le « capitalisme de la finitude » : les XVIe-XVIIIe siècles, 1880-1945 et de 2010 à nos jours.
Orain définit ce capitalisme comme « une vaste entreprise navale et territoriale de monopolisation d'actifs — terres, mines, zones maritimes, personnes esclavagisées, entrepôts, câbles sous-marins, satellites, données numériques — menée par des États-nations et des compagnies privées afin de générer un revenu rentier en dehors du principe concurrentiel » . L'expression « capitalisme de la finitude » met en exergue le moteur de ce phénomène : « un sentiment angoissant (continuellement réactivé), suggéré par des élites, mais largement diffusé dans les opinions publiques : celui d’un monde "fini", autrement dit borné, limité, qu'il faut s'accaparer dans la précipitation »
Après la première colonisation, qui se termine à la fin du XVIIIe siècle, le besoin croissant de matières premières pour alimenter l'économie justifie à nouveau, à la fin du siècle suivant, un second colonialisme et une rivalité accrue entre les nations. Le sentiment d'une limitation et d'une raréfaction des ressources, qui redevient prégnant à partir de 2010, notamment en lien avec la transition énergétique, relance ensuite également la course à l'accaparement.
Orain examine ce capitalisme de la finitude sous trois angles : la fermeture et la privatisation des mers et le rôle que peuvent jouer dans ce contexte les marines de guerre et marchandes ; la relégation au second plan des mécanismes de marché dans les échanges internationaux, au profit d’échanges au sein de zones protégées, de monopoles, d’ententes et de coercition violente ; et enfin l’accaparement de ressources à l’international, reposant sur le contrôle par des entreprises publiques ou privées de vastes espaces.
Pour illustrer ses hypothèses, Orain s’appuie sur des discours de contemporains, parfois peu connus ou quelque peu oubliés, tels que l'officier de marine Alfred Mahan (1840-1914), le professeur d'économie William Cunningham (1849-1919) ou l'économiste et historien Gustav Schmoller (1838-1917), qui ont tous les trois écrit à une époque où le protectionnisme et les ambitions coloniales renaissent, après 1880. Orain détaille également les outils concrets par lesquels ces orientations ont été mises en œuvre et montre la persistance de ceux-ci aux différentes périodes qu’il examine. Cette approche, qui ignore délibérément les développements souvent formalisés et abstraits de la discipline de l’économie internationale, fait le choix d’une économie descriptive.
Karl Polanyi situe l’apogée du capitalisme entre 1830 et 1930, période durant laquelle le système de marché autorégulé s’impose, entraînant la marchandisation de la terre, du travail et de la monnaie. Après la Seconde Guerre mondiale, nos sociétés connaîtront une démarchandisation partielle du travail et de la monnaie. Toutefois, la révolution néolibérale des années 1980 est perçue par de nombreux critiques comme une nouvelle poussée de ce système. Depuis 2010, ce dernier doit faire face à une série de crises de plus en plus graves.
L’économiste et historien Arnaud Orain propose une périodisation différente dans son ouvrage Le Monde confisqué. Il y retrace l’histoire d’un capitalisme qu’il décrit comme « capitalisme de la finitude » — qu’on pourrait aussi qualifier de « capitalisme d’accaparement » — s’étendant du XVIe siècle à nos jours, dont il affirme qu’il réapparaît périodiquement en dehors des périodes durant lesquelles le capitalisme libéral réussit à s’imposer.
La résurgence périodique d’une volonté d’accaparement des ressources à l’international
Son analyse se concentre principalement sur les échanges internationaux – davantage de biens que de services – laissant ainsi de côté d’autres dimensions généralement considérées dans l’analyse du capitalisme et de son émergence. Selon Orain, les périodes où le capitalisme libéral et le libre-échange dominent se limitent à deux séquences : de 1815 à 1880 (avec un pic entre 1850 et 1870) et de 1945 à 2010 (jusqu’en 1980, sous une forme tempérée par l’intervention publique). À l’inverse, il identifie trois périodes clés durant lesquelles prédomine le « capitalisme de la finitude » : les XVIe-XVIIIe siècles, 1880-1945 et de 2010 à nos jours.
Orain définit ce capitalisme comme « une vaste entreprise navale et territoriale de monopolisation d'actifs — terres, mines, zones maritimes, personnes esclavagisées, entrepôts, câbles sous-marins, satellites, données numériques — menée par des États-nations et des compagnies privées afin de générer un revenu rentier en dehors du principe concurrentiel » . L'expression « capitalisme de la finitude » met en exergue le moteur de ce phénomène : « un sentiment angoissant (continuellement réactivé), suggéré par des élites, mais largement diffusé dans les opinions publiques : celui d’un monde "fini", autrement dit borné, limité, qu'il faut s'accaparer dans la précipitation »
Après la première colonisation, qui se termine à la fin du XVIIIe siècle, le besoin croissant de matières premières pour alimenter l'économie justifie à nouveau, à la fin du siècle suivant, un second colonialisme et une rivalité accrue entre les nations. Le sentiment d'une limitation et d'une raréfaction des ressources, qui redevient prégnant à partir de 2010, notamment en lien avec la transition énergétique, relance ensuite également la course à l'accaparement.
Orain examine ce capitalisme de la finitude sous trois angles : la fermeture et la privatisation des mers et le rôle que peuvent jouer dans ce contexte les marines de guerre et marchandes ; la relégation au second plan des mécanismes de marché dans les échanges internationaux, au profit d’échanges au sein de zones protégées, de monopoles, d’ententes et de coercition violente ; et enfin l’accaparement de ressources à l’international, reposant sur le contrôle par des entreprises publiques ou privées de vastes espaces.
Pour illustrer ses hypothèses, Orain s’appuie sur des discours de contemporains, parfois peu connus ou quelque peu oubliés, tels que l'officier de marine Alfred Mahan (1840-1914), le professeur d'économie William Cunningham (1849-1919) ou l'économiste et historien Gustav Schmoller (1838-1917), qui ont tous les trois écrit à une époque où le protectionnisme et les ambitions coloniales renaissent, après 1880. Orain détaille également les outils concrets par lesquels ces orientations ont été mises en œuvre et montre la persistance de ceux-ci aux différentes périodes qu’il examine. Cette approche, qui ignore délibérément les développements souvent formalisés et abstraits de la discipline de l’économie internationale, fait le choix d’une économie descriptive.