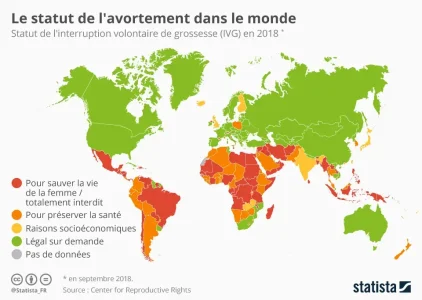pour éclairer le contexte social de l'abandon d'enfants et de la réalité des mères célibataires, et des lacunes du système de la kafala
http://www.babelmed.net/article/2810-la-kafala-une-adoption-qui-nen-est-pas-une/
La kafala, une adoption qui n’en est pas une
Marianne Roux-Bouzidi - 08/08/2012
(...)
Dans le cas de la
kafala judiciaire la démarche des tuteurs s’inscrit clairement dans une logique d’adoption. Il s’agit de recueillir un enfant abandonné qui se trouve dans une structure d’accueil pour orphelins. Après une ébauche de première loi en 1993 c’est véritablement le dahir royal du 13/06/2002 qui régit les modalités de la prise en charge de ces enfants ostracisés. En effet, il a fallu ce laps de temps pour que les autorités prennent conscience du phénomène des abandons d’enfants, qui s’est amplifié dans les années 80-90, et tentent d’élaborer une réponse adaptée à cette évolution.
Les abandons, conséquence de l’opprobre à l’égard des mères célibataires
En 2010 une étude menée par l’Unicef et la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance sur l’enfance abandonnée au Maroc faisait état de la situation de manière alarmante. Alors que le chiffre officiel pour l’année 2008 recensait 4554 enfants abandonnés à la naissance, il a été admis qu’il fallait le r
evoir à la hausse (tous les abandons n’étant pas comptabilisés) pour atteindre 2% du total des naissances du pays, donc 6840 enfants.
L’enquête indique que la
plupart des abandons d’enfants est le fait de femmes célibataires (80,9 %) vivant en zone urbaine (75 %) et que les garçons sont plus souvent abandonnés que les filles (de 53 % à 65 % selon les régions). Le « profil type » est une femme de ménage/ouvrière ou sans emploi, âgée de 21 à 30 ans, n’ayant pas reçu d’éducation ou juste le niveau élémentaire. Par ailleurs, il est intéressant de noter que ces enfants sont en grande majorité le
fruit d’une relation sexuelle consentie suite à une promesse de mariage non tenue. Si elles indiquent abandonner leur enfant pour raisons économiques, il est évident que cet acte est d’abord vécu comme « le prix à payer » pour ne pas être exclues de leur famille et de la société en général, affirme le rapport.