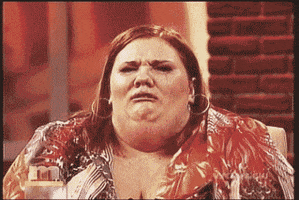@kuzaylaznat pour toi et tes sbires envoyé pro généraux

Ce billet fait partie d’une série d’articles (dont les prochains sont à paraître). Ces articles sont issus d’un programme de recherche, Histoire et mémoire : le Maroc des années de plomb 1956-1999, soutenu par divers partenaires : CNDH (Conseil national des droits de l’homme), IER (Instance équité et réconciliation), CJB (Centre Jacques Berque) et UE (Union européenne).
Un colloque, tenu en 2014, a permis la restitution des résultats de recherche de ce programme. Leur diffusion à travers ce carnet permet d’élargir l’audience auprès d’un plus large public.
« Les gens du Nord ont autrefois connu la violence du Prince héritier, il vaudrait mieux pour eux qu’ils ne connaissent pas celle du Roi ». C’est ainsi qu’Hassan II (1961-1999) s’adresse aux habitants du nord-ouest du Maroc (et à travers eux à l’ensemble de la population) en réaction aux émeutes populaires de 1984. Adoptant alors un ton grave et méprisant, le monarque rappelle à ses sujets qu’il est capable de tout pour conserver le pouvoir. Pour leur rafraîchir la mémoire, il n’hésite pas à faire une allusion brève mais ô combien symbolique à la répression féroce qu’il a menée contre ces mêmes régions vingt-cinq ans auparavant. Le choix rhétorique du souverain n’est pas anodin, renvoyant, consciemment ou inconsciemment, à l’un des épisodes les plus importants et les moins connus de l’histoire du Maroc contemporain : le soulèvement du Rif (1958-1959). Événement dramatique s’il en est, ce soulèvement cristallise à lui seul toutes les tensions, les contradictions et les luttes sociopolitiques qui ont caractérisé l’espace marocain au lendemain de l’indépendance. Lever le voile sur ce conflit permettra non seulement de mieux connaître cette partie floue de l’histoire du Maroc mais également de jeter une nouvelle lumière sur la genèse du système Hassan II.
Poussée par une sorte d’instinct darwinien et inspirée par une haute estime de sa fonction, la monarchie décide très rapidement de passer à l’offensive même si le contexte régional n’est pas favorable (les dynasties égyptienne, tunisienne et iraquienne ont été renversées dans les années 1950). D’une part, elle exploite toutes les faiblesses du PI (luttes intestines, divisions idéologiques, inexpériences de ses cadres, ambitions personnelles, quasi-absence dans le milieu rural, etc.). D’autre part, elle attise les craintes de ceux qui redoutent les prétentions hégémoniques du PI, notamment la France, les notables ruraux, les militaires et les petits partis. En agissant de la sorte, la monarchie se pose comme la seule garante de la marche de l’État et des intérêts de chacun de ces groupes. Elle réussit ainsi à rassembler une large coalition avec la bénédiction de l’ancienne puissance tutélaire.

Ce billet fait partie d’une série d’articles (dont les prochains sont à paraître). Ces articles sont issus d’un programme de recherche, Histoire et mémoire : le Maroc des années de plomb 1956-1999, soutenu par divers partenaires : CNDH (Conseil national des droits de l’homme), IER (Instance équité et réconciliation), CJB (Centre Jacques Berque) et UE (Union européenne).
Un colloque, tenu en 2014, a permis la restitution des résultats de recherche de ce programme. Leur diffusion à travers ce carnet permet d’élargir l’audience auprès d’un plus large public.
« Les gens du Nord ont autrefois connu la violence du Prince héritier, il vaudrait mieux pour eux qu’ils ne connaissent pas celle du Roi ». C’est ainsi qu’Hassan II (1961-1999) s’adresse aux habitants du nord-ouest du Maroc (et à travers eux à l’ensemble de la population) en réaction aux émeutes populaires de 1984. Adoptant alors un ton grave et méprisant, le monarque rappelle à ses sujets qu’il est capable de tout pour conserver le pouvoir. Pour leur rafraîchir la mémoire, il n’hésite pas à faire une allusion brève mais ô combien symbolique à la répression féroce qu’il a menée contre ces mêmes régions vingt-cinq ans auparavant. Le choix rhétorique du souverain n’est pas anodin, renvoyant, consciemment ou inconsciemment, à l’un des épisodes les plus importants et les moins connus de l’histoire du Maroc contemporain : le soulèvement du Rif (1958-1959). Événement dramatique s’il en est, ce soulèvement cristallise à lui seul toutes les tensions, les contradictions et les luttes sociopolitiques qui ont caractérisé l’espace marocain au lendemain de l’indépendance. Lever le voile sur ce conflit permettra non seulement de mieux connaître cette partie floue de l’histoire du Maroc mais également de jeter une nouvelle lumière sur la genèse du système Hassan II.
Enjeux de pouvoir
Au lendemain de l’indépendance, le Maroc vit ce que l’on appelle une situation révolutionnaire. Cela veut dire que plusieurs factions politiques expriment des prétentions inconciliables à monopoliser l’État ou à être l’État. Après le « retrait » de la France, souverain effectif de la plus grande partie du pays depuis presque un demi-siècle, plusieurs acteurs se disputent âprement le contrôle du pouvoir. Si les deux principaux acteurs sont incontestablement la monarchie et le parti Istiqlal (PI), il ne faut pas oublier les notables ruraux, les officiers marocains de l’armée française, les différents groupes de résistants (Armée de Libération Nationale, ALN, fida’yyoun, etc.) et les petits partis tels qu’al-Shoura wa al-istiqlal (PDI). Tous les moyens sont bons pour coopter, marginaliser ou même éliminer les rivaux (la propagande, la corruption, l’emprisonnement, l’assassinat, etc.). Néanmoins, les deux grands joueurs sont conscients que le monopole du pouvoir passe nécessairement par le contrôle effectif de l’appareil étatique hérité de la France, notamment les forces armées et la bureaucratie. Pour des raisons objectives et subjectives qu’il serait trop long d’évoquer ici, la première échoit à la monarchie et la seconde au PI. Une longue épreuve de force commence entre les deux parties.Poussée par une sorte d’instinct darwinien et inspirée par une haute estime de sa fonction, la monarchie décide très rapidement de passer à l’offensive même si le contexte régional n’est pas favorable (les dynasties égyptienne, tunisienne et iraquienne ont été renversées dans les années 1950). D’une part, elle exploite toutes les faiblesses du PI (luttes intestines, divisions idéologiques, inexpériences de ses cadres, ambitions personnelles, quasi-absence dans le milieu rural, etc.). D’autre part, elle attise les craintes de ceux qui redoutent les prétentions hégémoniques du PI, notamment la France, les notables ruraux, les militaires et les petits partis. En agissant de la sorte, la monarchie se pose comme la seule garante de la marche de l’État et des intérêts de chacun de ces groupes. Elle réussit ainsi à rassembler une large coalition avec la bénédiction de l’ancienne puissance tutélaire.