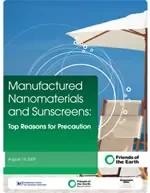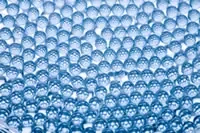Les dangers potentiels des Phtalates pour les hommes
Des chercheurs français de l’INSERMCEA et de l’université Paris 7 ont démontré que les phtalates étaient mauvais pour le système reproducteur masculin.
Voici un extrait du communiqué de presse :
Les chercheurs de l’Unité Mixte de recherche Gamétogenèse et Génotoxicité INSERMCEA-Université Paris 7 dirigée par René Habert, Professeur à l’Université Paris-Diderot Paris 7, a démontré expérimentalement que les phtalates, des composés biodégradables que l’on retrouve dans les plastiques dits souples, étaient délétères pour la mise en place du potentiel reproducteur masculin dans l’espèce humaine.
Le travail des chercheurs du laboratoire du Pr Habert est une première mondiale et vient d’être publié dans la revue Environmental Health Perspectives.
Au cours des dernières années, l’inquiétude et le débat se sont cristallisés sur l’augmentation des troubles de la reproduction masculine. De nombreuses études montrent clairement que la production spermatique humaine est en constante diminution.
Actuellement on estime que dans les pays industrialisés, un homme produit deux fois moins de spermatozoïdes que son grand-père n’en produisait au même âge. En outre, la fréquence du cancer testiculaire a augmenté de façon régulière au cours des dernières décennies. Enfin, il est probable que l’incidence des malformations congénitales des organes génitaux externes masculins soit aussi
en augmentation constante.
L’hypothèse la plus probable est que toutes ces anomalies de la reproduction masculine résultent d’une altération du développement du testicule pendant la vie foetale et néonatale. Des arguments épidémiologiques, cliniques et expérimentaux laissent supposer que ces troubles résultent des effets délétères des polluants qui agissent en perturbant le fonctionnement des hormones. Parmi ces perturbateurs endocriniens, plusieurs études incriminent les phtalates qui sont produits en très grandes quantités par les industries des plastiques. Cependant, jusqu’à présent aucune étude expérimentale n’avait mis en évidence un effet délétère des phtalates sur la reproduction humaine.
Les chercheurs de l’Unité Mixte de recherche Gamétogenèse et Génotoxicité INSERM-CEAUniversité Paris Diderot ont développé une collaboration avec le Service de Gynécologie-Obstétrique du Pr René Frydman pour mettre au point un système de culture original de testicules foetaux humains. Le Pr Virginie Rouiller-Fabre responsable de ce programme a réussi à reproduire dans une boîte de culture le développement du testicule observé in vivo.
Dans ce système, l’ajout de MEHP (Mono(Ethylhexyl)-phtalate), le métabolite actif du DEHP (Di(Ethylhexyl)-phtalate), un phtalate largement répandu, provoque au bout de 3 jours la disparition de 40% des cellules germinales foetales (…)
Pour lire l’intégralité du communiqué de presse de l’université de Paris diderot :
http://www.univ-paris-diderot.fr/2008/09-phtalates-reprotoxiques.pdf
Les doutes sur les phtalates
Les études menées sur les phtalates comme le DEHP et le DINP ont conclu qu’il fallait des concentrations relativement élevées de ces substances pour provoquer des anomalies chez les animaux de laboratoire, et que la grande majorité des personnes ne sont pas exposés à telles concentrations.
La Société canadienne du cancer (canadian cancer society) met en avant :
Les phtalates présents dans les matériels de PVC utilisés pour certaines interventions médicales : les fœtus et les jeunes enfants peuvent être exposés à des concentrations relativement élevées de DEHP lors de certains actes médicaux comme la dialyse, les transfusions sanguines et l’ECMO (oxygénation extracorporelle sur oxygénateur à membrane)
Les phtalates présents dans les jouets et les produits destinés aux jeunes enfants
Le manque d’information sur la présence de phtalates dans des objets courants, comme les jouets et les produits destinés aux jeunes enfants
Le manque relatif de données sur la sécurité des autres phtalates et des substances de remplacement
(Source : société canadienne du cancer 20 aout 2008)
Extrait du rapport de INRS sur les phtalates :
Les phtalates, produits à quelque 3 millions de tonnes par an dans le monde, sont présents partout à des niveaux différents dans notre environnement quotidien. L’exposition, souvent difficile à évaluer en raison de la multiplicité des sources potentielles et des situations, peut se produire par inhalation, par contact ou par ingestion.
La mise en évidence, durant la dernière décennie, de propriétés toxiques pour la reproduction ainsi que du caractère cancérogène de certains phtalates sur les rongeurs a provoqué des inquiétudes.
Le communiqué de presse du centre français d’informations sur les phtalates (2006) :
L’union européenne a confirmé que deux des plastifiants les plus utilisés ne figurent pas dans la liste des produits dangereux et que leur utilisation actuelle ne pose aucun risque ni à la santé humaine ni à l’environnement.
La publication dans le Journal Officiel de l’Union Européenne des résultats des évaluations de risques posés par les produits Di-‘isononyl’ phtalate (DINP) et Di-‘isodecyl’ phtalate (DIDP) marque la fin d’une évaluation scientifique de dix ans par les autorités de réglementation. Ces résultats confirment l’innocuité des produits pour les utilisateurs européens.
« Après des résultats aussi probants publiés par l’Union Européenne, le commun des utilisateurs peut continuer à faire usage des DINP et des DIDP en toute confiance », affirme le Dr David Cadogan, Directeur du Conseil Européen des Plastifiants et Produits Intermédiaires (ECPI).
Dans la foulée de l’adoption récente par l’Union Européenne de la législation concernant la commercialisation et l’utilisation des plastifiants DINP et DIDP dans les jouets et les articles pour enfants, les conclusions d’évaluation des risques publiées aujourd’hui dans le Journal Officiel indiquent clairement que des mesures supplémentaires de réglementation ne sont plus nécessaires quant à l’utilisation des DINP et DIDP.
Les rigoureuses évaluations de risques de l’UE incluent un haut degré de conservatisme et de facteurs d’innocuité intégrés. Elles ont été menées par la France (pays rapporteur), le Bureau Européen des Produits Chimiques, les États Membres sous la stricte supervision de la Commission Européenne. Elles fournissent une évaluation scientifique claire permettant de déterminer si oui ou non on peut en toute sécurité utiliser une substance particulière.
Les résultats des évaluations de risques d’un plastifiant spécialisé moins bien connu, le Di-n-butyl phtalate (DBP), ont également été publiés par le Journal Officiel de l’UE. Suite à ces évaluations, des mesures doivent être prises dans le cadre des Directives IPPC
(96/61/EC) et de la Directive 98/24/EC relative aux risques posés par les produits chimiques.
Dans ses remarques sur les implications plus larges des résultats pour les producteurs et les utilisateurs, le Dr Cadogan ajoute : » Une fois la nouvelle législation REACH mise en place, les conclusions des évaluations de risques et les recherches sur lesquelles ces conclusions reposent seront d’une grande utilité pour les producteurs et les utilisateurs de ces substances. »
Les produits phtaliques sont les plastifiants les plus utilisés dans le monde. Cette famille de produits est utilisée depuis plus de cinquante ans, principalement dans la fabrication du polychlorure de vinyle (PVC) flexible. Ils apportent des avantages à de nombreux produits largement utilisés dans des applications industrielles, commerciales, institutionnelles et grand public. Parmi ces dernières, citons les câbles souterrains et sous-marins, les fils électriques, les matériaux de construction, les enduits de protection des soubassements de carrosseries, les applications médicales, les revêtements de sols institutionnels et privés.
Communiqué de presse de SwissMedic en 2005 sur les phtalates et les médicaments (2005) :
voir la suite