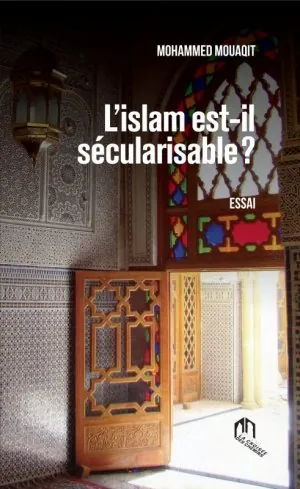Analyse intéressante sur l'évolution de l'islam depuis les indépendances.
qq extraits
Ce n’est qu’au sortir de la campagne d’Afghanistan que ces combattants vont se redéployer dans les pays d’origine et propager la violence armée à partir de groupuscules aguerris, constituant les ancêtres fondateurs d’Al-Qaida et de Daech. L’idéologie djihadiste se ressource théologiquement dans le hanbalo-wahhabisme, la doctrine de l’Etat saoudien, allié inconditionnel de l’Europe et des Etats-Unis. Si l’idéologie djihadiste se veut puritaine et révolutionnaire, elle ne conteste étrangement jamais le fondamentalisme du marché, la vulgate néolibérale, la rente de l’énergie fossile, la société matérialiste et la consommation infinie.
Il n’empêche qu’une sécularisation irréversible marquée par la politisation mais aussi par la marchandisation se poursuit en islam au travers d’une extension continue du profane au détriment du sacré. Finalement, que reste-t-il de sacré à La Mecque quand y est reproduit, à l’identique, l’urbanisme factice, kitsch et commercial de Las Vegas, cité du vice et du jeu ?
Paradoxalement, ce qu’on perçoit comme un retour du religieux est en réalité une sortie de l’islam. Cette « sortie » met en scène la religiosité dans la « mondanité » (au sens wébérien du terme), dans le règne de l’apparence et des signes ostentatoires : tel ce voile (hijab) qui ne signifie quasiment rien sur le plan théologique et symbolise tout l’islam au sein de la modernité occidentale, ce voile dont le port rend soudainement visible la femme musulmane – sujet de loi, de droit et de débat – et sans lequel elle reste invisible.
La sortie de l’islam essentialise l’accessoire (le paraître, l’habit, les normes) et accessoirise l’essentiel (l’articulation de la raison et de la foi). Elle témoigne d’un âge de la sécularisation, où, après avoir réinventé une tradition (spectre d’un passé glorifié et mythifié) et bricolé une théologie du repli dogmatique (réduite à des règles inopérantes ou caduques mais totalement orientée marché), on ne peut que constater le hiatus entre le régime discursif religieux et sa mise en acte.
qq extraits
Ce n’est qu’au sortir de la campagne d’Afghanistan que ces combattants vont se redéployer dans les pays d’origine et propager la violence armée à partir de groupuscules aguerris, constituant les ancêtres fondateurs d’Al-Qaida et de Daech. L’idéologie djihadiste se ressource théologiquement dans le hanbalo-wahhabisme, la doctrine de l’Etat saoudien, allié inconditionnel de l’Europe et des Etats-Unis. Si l’idéologie djihadiste se veut puritaine et révolutionnaire, elle ne conteste étrangement jamais le fondamentalisme du marché, la vulgate néolibérale, la rente de l’énergie fossile, la société matérialiste et la consommation infinie.
Il n’empêche qu’une sécularisation irréversible marquée par la politisation mais aussi par la marchandisation se poursuit en islam au travers d’une extension continue du profane au détriment du sacré. Finalement, que reste-t-il de sacré à La Mecque quand y est reproduit, à l’identique, l’urbanisme factice, kitsch et commercial de Las Vegas, cité du vice et du jeu ?
Paradoxalement, ce qu’on perçoit comme un retour du religieux est en réalité une sortie de l’islam. Cette « sortie » met en scène la religiosité dans la « mondanité » (au sens wébérien du terme), dans le règne de l’apparence et des signes ostentatoires : tel ce voile (hijab) qui ne signifie quasiment rien sur le plan théologique et symbolise tout l’islam au sein de la modernité occidentale, ce voile dont le port rend soudainement visible la femme musulmane – sujet de loi, de droit et de débat – et sans lequel elle reste invisible.
La sortie de l’islam essentialise l’accessoire (le paraître, l’habit, les normes) et accessoirise l’essentiel (l’articulation de la raison et de la foi). Elle témoigne d’un âge de la sécularisation, où, après avoir réinventé une tradition (spectre d’un passé glorifié et mythifié) et bricolé une théologie du repli dogmatique (réduite à des règles inopérantes ou caduques mais totalement orientée marché), on ne peut que constater le hiatus entre le régime discursif religieux et sa mise en acte.