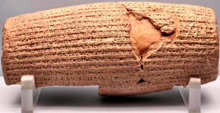Non, ce n'est pas le cadre politico-religieux qui importe le plus, tout juste est-il bon pour faciliter la récupération et la transmission des savoirs anciens. Mais il n'en est pas à l'origine. Une culture n'est vivace que lorsqu'il existe encore un peuple pour la transmettre. Ce qui a sauvé les savoirs des empires perses et byzantins, c'est la permanence de leur peuple malgré l'invasion islamique, permanence due à la rapidité de la conquête musulmane et au nombre limité des troupes d'occupation arabes. Le statut de dhimmi a d'ailleurs été inventé pour pallier à cette difficulté, car il était impossible aux musulmans de convertir par la force une population numériquement supérieure.
Comme depuis hier, des affirmations réductrices. Oui, le monde islamique a récupéré des savoirs antiques (grecs, perses, indiens), mais il ne s’est pas contenté de les conserver. Il les a critiqués, traduits, commentés, développés, parfois corrigés, et surtout transmis à l’Europe médiévale, ce qui a été un élément clé de la Renaissance.
Al-Khwarizmi ne s’est pas contenté d’utiliser les mathématiques indiennes, il a fondé l’algèbre. "Avicenne" n’a pas juste lu Hippocrate ou Galien, il a produit des œuvres comme Le Canon de la médecine, utilisées en Europe jusqu’au XVIIe siècle. Les Maisons de la sagesse à Bagdad n’étaient pas de simples bibliothèques, mais de véritables centres de recherche pluridisciplinaires. Le cadre politico-religieux a donc été fondamental : la stabilité du califat abbasside, la promotion de la science par des califes comme Al-Ma’mûn, et l’usage de l’arabe comme langue scientifique commune ont permis cet essor.
Oui, les peuples conquis ont contribué à la préservation de certains savoirs (ex. : les chrétiens nestoriens traducteurs du syriaque vers l’arabe), mais sans l’élan scientifique porté par la civilisation islamique, ces savoirs seraient probablement restés lettre morte. Par ailleurs, la science islamique n’est pas un simple relais des sciences antiques : elle les a réinterprétées, enrichies et synthétisées avec des apports perses, indiens et même chinois (en astronomie, médecine, géographie, etc.).
Pour ce qui est du statut de dhimmi : je ne cesse de le répéter depuis mes échanges avec ton acolyte non-moins pervers que toi
@julian13 : en bon pervers que vous êtes, vous avez une lecture anachronique et orientée. Le statut de dhimmi n’a pas été « inventé » pour résoudre un problème militaire, mais s’inscrit dans la tradition islamique d’octroyer aux « gens du Livre » (chrétiens et juifs) une protection légale contre un impôt (jizya), en échange de leur autonomie religieuse et sociale. C’était un compromis juridique et théologique, même s'il n'est plus acceptable aujourd'hui, offfrait un statut plus tolérant que ce que subissaient les minorités religieuses dans l’Europe chrétienne médiévale. Quant aux conversions, elles furent majoritairement progressives et volontaires, sur plusieurs siècles. Il n’y avait aucune obligation de se convertir dans les premiers siècles, et la conversion pouvait même priver le pouvoir de recettes fiscales.
Précisément parce que leur territoire était vaste et qu'ils étaient numériquement inférieurs aux populations envahies, les musulmans n'ont eu d'autre choix que de constituer un empire. Le propre des empires, c'est leur caractère multi ethnique et plurireligieux, lui-même conséquence de leur taille. Il est en effet impossible d'uniformiser rapidement un territoire aussi vaste et culturellement aussi divers. Le phénomène de syncrétisme que vous décrivez ne résulte donc pas d'un choix politique mais d'une nécessité politique et d'une adaptation pratique. Les Arabes ne pouvaient tout simplement pas faire autrement que de cohabiter avec des peuples différents dont ils étaient devenus les maîtres.
Manoeuvre perverse : faire d'une contrainte universelle un défaut particulier à la personne ou l'objet qu'on veut dénigrer.
L’argument selon lequel le syncrétisme islamique n’était qu’un "choix contraint" n'est pas propre aux empires musulmans : tous les empires, de Rome à la Chine, en passant par les empires chrétiens (byzantin, carolingien, espagnol), ont dû composer avec la diversité culturelle et religieuse. Cela ne nie en rien les intentions politiques, philosophiques ou théologiques de leurs dirigeants à intégrer, tolérer, voire valoriser cette diversité.
Ce qui est remarquable chez les musulmans, ce n’est pas juste qu’ils ont cohabité avec d’autres peuples, mais la manière dont ils l'ont fait à certains moments clés de l’Histoire : précisément en traduisant massivement les œuvres grecques, syriaques, perses et indiennes, en accueillant juifs et chrétiens dans leurs structures intellectuelles, et en inventant des formes nouvelles de pensée.