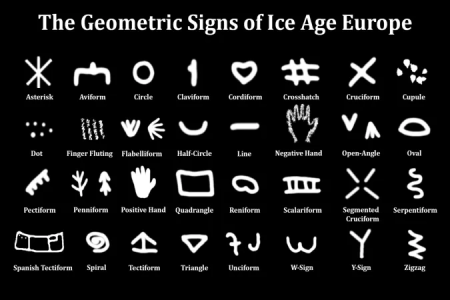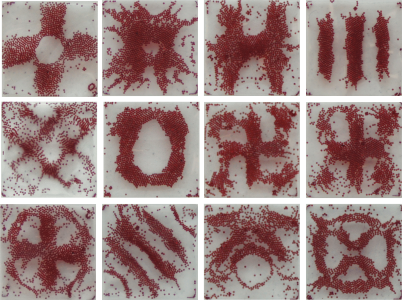tajali
VIB
2 choses sont à l'origine des religions :
l'emerveillement face à l'ordre (equilibre) du monde (vie)
mais surtout la question du mal qui rompt cette harmonie (desequilibre mort)
l'origine des religions pourrait être double —
l’émerveillement devant l’ordre du monde (le sacré)
et l’angoisse devant le mal (le chaos).
Le mal pousse à chercher un sens,
mais l’ordre perçu pousse à croire en une volonté derrière le cosmos.
le mal prend sens avec le ressenti : douleur, souffrance, privation.
Sans conscience ou perception, le mal est indéfinissable.
une bacterie qui mange l'autre est deja une forme de mal
D’un point de vue humain, oui, c’est mal.
Mais pour la bactérie, c’est juste survie — ni bien ni mal.
Le mal implique toujours un jugement moral et une conscience qui ressent la souffrance.
Le mal naît avec la vie : souffrance, prédation, mort.
Dès qu’il y a sentir, il y a peur, douleur, manque.
Le mal est coextensif à la conscience du vivant.
www.bladi.info/threads/pourquoi-dieu-a-t-il-cree-le-mal.537447/
au debut cette question devait etre pragmatique :
comment distingué le bon du mauvais ? c'etait une question de survie ...
www.bladi.info/threads/pourquoi-allah-a-creer-des-gens-moches-et-des-gens-beaux.266950/page-5#post-17722020
www.bladi.info/threads/cybernetique-qui-a-compris-c-etait-quoi.449115/#post-14991435
www.bladi.info/threads/le-soleil-et-les-saisons-a-lorigine-de-limage-de-dieu-et-des-religions.526313/page-2
l'emerveillement face à l'ordre (equilibre) du monde (vie)
mais surtout la question du mal qui rompt cette harmonie (desequilibre mort)
l'origine des religions pourrait être double —
l’émerveillement devant l’ordre du monde (le sacré)
et l’angoisse devant le mal (le chaos).
Le mal pousse à chercher un sens,
mais l’ordre perçu pousse à croire en une volonté derrière le cosmos.
le mal prend sens avec le ressenti : douleur, souffrance, privation.
Sans conscience ou perception, le mal est indéfinissable.
une bacterie qui mange l'autre est deja une forme de mal
D’un point de vue humain, oui, c’est mal.
Mais pour la bactérie, c’est juste survie — ni bien ni mal.
Le mal implique toujours un jugement moral et une conscience qui ressent la souffrance.
Le mal naît avec la vie : souffrance, prédation, mort.
Dès qu’il y a sentir, il y a peur, douleur, manque.
Le mal est coextensif à la conscience du vivant.
www.bladi.info/threads/pourquoi-dieu-a-t-il-cree-le-mal.537447/
au debut cette question devait etre pragmatique :
comment distingué le bon du mauvais ? c'etait une question de survie ...
www.bladi.info/threads/pourquoi-allah-a-creer-des-gens-moches-et-des-gens-beaux.266950/page-5#post-17722020
www.bladi.info/threads/cybernetique-qui-a-compris-c-etait-quoi.449115/#post-14991435
www.bladi.info/threads/le-soleil-et-les-saisons-a-lorigine-de-limage-de-dieu-et-des-religions.526313/page-2
Dernière édition: